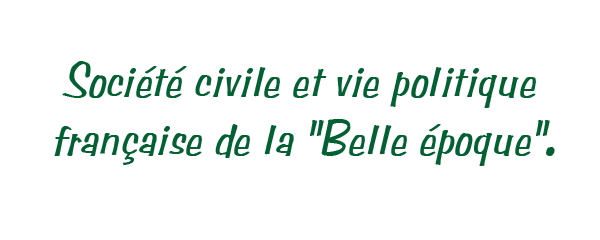|
1871.
La Commune,
le traité de Francfort,
Adolphe Thiers président.
22
janvier.
- Jules
Favre - alors Ministre des affaires étrangères
- est délégué auprès de Bismarck.
-
Le 28, les pourparlers qui durent depuis cinq jours
n'ont permis de fléchir l'intransigeance de Bismarck,
une convention est signée à 10 heures du soir,
elle donne aux Français un délai de 21 jours
pour leur permettre l'élection d'une Assemblée
à même de ratifier un traité de Paix.
8
février.
- Convoquées
par décret du 31 janvier, les élections donnent
les résultats suivants : 675 députés
élus dont 400 de tendance royaliste.
- Thiers
très populaire est élu dans 26 départements.
 |
-
Réunie à Bordeaux l'Assemblée se
donne Jules Grévy comme président,
et comme mission : signer un traité avec la Prusse. |
|
Jules
Grévy.
|
|
26
février.
- Une
délégation de l'Assemblée signe à
Versailles les préliminaires d'un traité de
paix ne laissant guère de place à la discussion.
10
mars.
- A
son retour, Thiers déclare aux députés
"Je jure de ne préparer,
sous le rapport des questions constitutionnelles, aucune
solution à votre insu qui serait de ma part une sorte
de trahison."
- C'est
le "Pacte de Bordeaux" que l'Assemblée
accepte à l'unanimité.
18
mars.
"La
Commune".
|
-
Alors que le gouvernement quitte Paris pour Versailles
et donne ordre à l'armée dont il redoute
la défection de s'y replier, conséquence
déplorable de cette retraite le "Comité
central de la garde républicaine"
se substitue au pouvoir légal, entraînant
par le pouvoir insurrectionnel la prise de possession
des ministères, de l'Etat-major, de la place
militaire, de l'imprimerie Nationale, de l'Hôtel
de Ville, de la plupart des mairies…, la population
refuse la capitulation.
-
L'émeute se déclenche lorsque Thiers
veut récupérer les canons de Montmartre
et de Belleville.
|
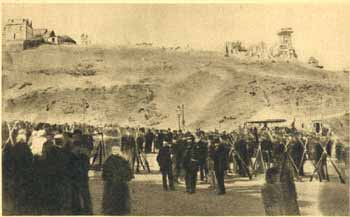
Montmartre
-
Les gardes nationaux protégent les canons
|
-
Le 26, installé en l'Hôtel de ville, le
"Comité" procède à
des élections.
| -
Face au gouvernement de l'Assemblée à
Versailles dont Thiers est devenu chef, "La
Commune" forme un gouvernement indépendant
composé de 40 membres, adopte le drapeau rouge,
décrète l'extension de l'autonomie de
"La Commune" à toute la France,
élabore un programme d'urgence… |
|
- Le
2 avril commencent les hostilités entre les troupes
de Versailles et les insurgés, qui subissent leur
première défaite à Courbevoie. Contraints
d'un repli sur Paris, ils abandonnent une centaine de morts
quelques soldats que l'on fusille ; la lutte s'installe
dans les rues de Paris, des barricades s'élèvent…,
ces combats de rues laissent de nombreux victimes.

Barricades
rue Charonne, gardes nationaux, place Vendôme &
rue de la Paix.
- En
province, dans les centres ouvriers, contre-coup quasi immédiat
de ce mouvement populaire, Marseille, Le Creusot, Saint
Etienne, Narbonne…, enregistrent combats de rues, morts.
- En
Avril, mai, jusqu'au 21 - date de l'entrée
des "Versaillais" dans Paris et par la Porte de
Saint Cloud - des luttes acharnées opposent les
"fédérés" aux troupes
commandées par Mac Mahon, les insurgés arrêtés
sont fusillés par centaines.
- Ainsi
pendant "la semaine sanglante",
les Français se fusillent entre eux, le 25,
62 le sont rue Haxo, le 27, les "fédérés"
qui ne sont point morts sur les barricades sont fusillés
au Père Lachaise au "Mur des fédérés"
qui acquiert ainsi une lugubre célébrité,
le 28, proclamation est affichée sur les murs de
Paris.
|
République
Française.
Habitants
de Paris, l'armée de France
est venue vous sauver.
Paris
est délivré. Nos soldats ont enlevés
à quatre heures les dernières
positions
occupées par les insurgés.
Aujourd'hui
la lutte est terminée,
l'ordre, le travail et la sérénité
vont renaître.
Quartier
général, le 28 mai 1871.
Le Maréchal de France, commandant
en chef :
De Mac-Mahon, Duc de Magenta. |
|
|
|
 |
- La
"guerre civile" est terminée, Thiers
annonce la victoire des "Versaillais",
le rôle de Thiers surnommé par Henri Rochefort
"Le sanguinaire" contraste singulièrement
avec Mac-Mahon qui prétendait : "Quant
un prisonnier est blessé, on ne peut le fusiller".
- On
compte officiellement 1 000 tués dans les troupes
versaillaises, 20 000 exécutions sans jugement par
les "Versaillais", 13 000 condamnations
de déportation.
- L'état
de siège est maintenu, et l'on prétend que
"La Commune" à fait 100 000 morts.
10
mai - Le traité de Francfort.
-
"Hôtel du Cygne" de Francfort, au nom
de la France, Jules Favre et Adolphe Thiers
concluent avec l'Allemagne un traité de paix
qui met fin à la guerre franco-prussienne.
Ancienne
terre du Saint empire germanique conquise deux siècles
plus tôt par Louis XIV, la cession des deux départements
alsaciens est revendication incontournable.
Qui
plus est, comme juste compensation des sacrifices de la
guerre, les Français se voient également réclamer
Metz et la Lorraine du nord, revendications
territoriales - 14 000 km², 1,6 millions d'habitants
- auxquelles s'ajoute une indemnité de guerre chiffrée
à six milliards de francs or de l'époque -
une somme colossale - la guerre quant à elle
aurait coûté plus de 15 milliards de franc
or.
L'indemnité
réduite à cinq milliards - en bon bourgeois,
Thiers confie plus tard qu'il est toujours possible de récupérer
des provinces perdues mais que les milliards envolés
le sont à jamais! - il est alors convenu que
les troupes d'occupation se retireront au fur et à
mesure du versement de l'indemnité.
Au terme
d'épuisantes négociations, Thiers obtient
que la place forte de Belfort qui a résisté
au-delà de l'armistice, soit conservée à
la France en échange du droit pour les Allemands
de défiler à Paris à partir du 1er
mars 1871 et ce jusqu'à la ratification du traité
par les élus français.
31
août.
- Le
vote de la loi Rivet confère à Thiers,
alors chef du pouvoir exécutif, le titre de "chef
du pouvoir exécutif de la République Française",
c'est à dire à la fois chef de l'état
et du gouvernement.
| "…
Quand je fus chargé des affaires, j'eus immédiatement
cette double préoccupation de conclure la paix
et de soumettre Paris." |
|
| |
Adolphe
Thiers.
|
|